Droit international : faut-il continuer à mobiliser cet outil de domination ?
Le droit international est régulièrement utilisé dans les luttes de libération des peuples opprimés. Mais dans les faits, il semble surtout servir les intérêts des États occidentaux. On fait le point.
“Le Statut de Rome ne s’applique pas à Israël ni aux États-Unis, ou à la France, à l’Allemagne, au Royaume-Uni, parce qu’il n’a pas été conçu pour nous poursuivre nous.” Ces propos, tenus il y a près d’un an par Lindsey Graham, sénateur américain allié de Donald Trump, sont clairs : les États occidentaux se considèrent comme étant au-dessus de la Cour pénale internationale (CPI). Depuis sa création en 2002, la Cour est notamment compétente à l’égard du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.
Le 21 novembre 2024, elle délivre un mandat d’arrêt à l’encontre de Benjamin Netanyahu. Ce dernier est suspecté d’être “responsable des crimes de guerre consistant à affamer délibérément des civils comme méthode de guerre et à diriger intentionnellement une attaque contre la population civile ; et des crimes contre l’humanité de meurtres, de persécutions et d’autres actes inhumains, du 8 octobre 2023 au moins jusqu’au 20 mai 2024 au moins”. Les États occidentaux qui font partie de la CPI sont ainsi tenus de l’arrêter s’il se trouve sur leur territoire. Mais la majorité d’entre eux refuse d’exécuter le mandat d’arrêt. Pure provocation, la Hongrie accueille même le Premier ministre israélien avec les honneurs militaires.
Cet exemple, comme des dizaines d’autres, illustre la facilité et l’impunité avec lesquelles les États du Nord global violent le droit international. Émergent alors des questions légitimes : le droit international est-il vraiment pertinent ? Dans quelle mesure faut-il continuer à y recourir dans nos luttes ? Quels leviers mobiliser pour obtenir justice ?
La souveraineté, un principe d’égalité réservé aux européens
Pour apporter des pistes de réponses à ces interrogations, commençons par un peu d’histoire. Dans quel contexte le droit international moderne est-il né ? Sans grande surprise, ses principes se développent dans un contexte européen impérialiste et colonial. Dès le XVIe siècle, le juriste et théologien espagnol Francisco de Vitoria travaille sur la conquête espagnole. “Il reconnaît une humanité et une forme de souveraineté aux peuples autochtones des Amériques, alors appelés “Indiens”, mais il les soumet à des lois pensées à partir des normes européennes, explique Océane Toukam, juriste en droits humains. Ainsi, toute résistance à la domination coloniale est présentée comme une violation du droit.”
Un siècle plus tard, les Traités de Westphalie consacrent la souveraineté comme principe d’égalité entre les États européens. Plus question désormais de violer les frontières des pays voisins ni d’intervenir dans leurs affaires domestiques. Mais cela ne s’applique pas aux peuples colonisés : “Ils sont exclus du cercle des États souverains, ce qui participe activement au maintien de la colonisation sous prétexte de “développement”.”
Les Européens nient par ailleurs complètement les corps juridiques existants dans les pays du Sud global. “Il existe déjà des traités entre les différents royaumes africains, des accords diplomatiques entre les différents peuples autochtones ou entre les empires asiatiques. La différence est que certains de ces accords étaient oraux ou, si écrits, ils ont été tout de même relégués pour une application des normes européennes jugées “universelles”.”

La Seconde Guerre européenne - elle n’est mondiale que d’un point de vue eurocentré - constitue une autre étape clé dans le développement du droit international. Pour éviter de reproduire les atrocités de la guerre, les États occidentaux forgent un ensemble de mécanismes juridiques et politiques au niveau international. “L’Organisation des Nations Unies est notamment fondée à ce moment-là avec une charte, précise Insaf Rezagui, docteure en droit international public à l’Université Paris Cité. Elle regroupe aujourd’hui 193 États mais à l’époque, elle n’en comptait que 51 parce que la plupart des populations étaient placées sous occupation et colonisées par des puissances impériales, principalement européennes.”
Ces dernières sont donc en grande partie à l’origine du droit international, qui devient un outil leur permettant de défendre leurs intérêts. En témoigne l’usage de la dichotomie raciale qui oppose les “nations civilisées” aux “nations barbares” et qui justifie le principe de mise sous tutelle des pays du Sud global. Cette idéologie raciste est toujours largement mobilisée aujourd’hui, à la fois au niveau international pour justifier la colonisation de la Palestine et aux niveaux nationaux, notamment pour normaliser les violences à l’encontre des personnes issues des migrations post-coloniales.
Autre exemple frappant : le droit de véto que se sont arrogé la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Organe exécutif de l’ONU, le Conseil de sécurité est chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. “Qui a cette responsabilité immense ? Cinq États, dont certains étaient encore de grands empires coloniaux à l’époque, qui peuvent empêcher l’adoption de projets de résolution qui condamnent des crimes de masse, obligent l’accès à l’aide humanitaire, etc. Ils peuvent aussi empêcher l’adoption de sanction des États qui ne respectent pas le droit international.”
Or, le Conseil de sécurité est le seul organe de l’ONU pouvant adopter des mesures coercitives contraignantes contre les États. “Le problème, c’est que ces grandes puissances forment un cercle de dominants qui se protègent entre eux et qui protègent leurs alliés, dont Israël.”
Et les pays du Sud global ?
Quant aux territoires colonisés par les pays européens, ils se voient imposer des lois qui les infériorisent et normalisent la colonisation. Mais les peuples indigènes ne se laissent pas faire. Dès le départ, ils mettent en place des actions de résistance face aux occupants. Au XXe siècle, les mouvements anticoloniaux, qui luttent pour les Indépendances, gagnent du terrain. En 1961, le mouvement des Non-Alignés est officiellement constitué. Il réunit des pays du Sud global qui refusent de s’inscrire dans la logique binaire des blocs de l’Est et de l’Ouest et qui entendent aller au bout des processus de décolonisation.
Ces États mobilisent le droit international à leur avantage. Ils parviennent notamment à faire reconnaître le droit des peuples à l’autodétermination. “Ce droit apparaît à l’article 1§2 de la Charte des Nations Unies ainsi que dans des résolutions clés comme la résolution 1514 (déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux) adoptée en 1960, précise Océane Toukam. Cette norme a par exemple servi dans les luttes de libération en Algérie.”
Autre victoire essentielle : la condamnation de l’apartheid sud-africain. “C’est la victoire du droit international sur le droit national des Blancs d’Afrique du Sud, qui était soutenu par tout le monde, comme Israël l’est aujourd’hui”, analyse l’avocate Selma Benkhelifa. Plus récemment, les États du Sud global ont obtenu la reconnaissance du génocide des Héréros et des Namas par l’Allemagne, quand l’actuelle Namibie était une colonie allemande.
Plusieurs jugements de la Cour Internationale de Justice (CIJ) leur sont par ailleurs favorables, au détriment d’États occidentaux. C’est par exemple le cas dans l’affaire qui oppose le Nicaragua aux États-Unis en 1986. Le gouvernement nicaraguayen accuse les USA de soutenir l’opposition armée et par conséquent de violer le droit international. “Les États-Unis sont condamnés pour la violation de plusieurs principes onusiens dont la non-intervention, le non-recours à la force et le respect de la souveraineté d’un autre État. Même si Washington a refusé d’exécuter la décision, ce verdict a marqué une victoire symbolique et juridique majeure pour un pays du Sud face à une grande puissance”, souligne Océane Toukam.
Le droit, un rapport de force asymétrique
Dans l’ensemble, les États du Sud global doivent ainsi se contenter de victoires principalement symboliques. Ils obtiennent certes la condamnation du colonialisme, la reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, celle du droit à la résistance (“le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter par tous les moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la liberté et à l’indépendance”) et à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. “Le droit international en soi, il est très bien. Il y a énormément de textes qui parlent du droit au retour des réfugiés, du fait que les colonies sont totalement illégales”, pointe Selma Benkhelifa.
Mais les textes ne sont que cela : des textes. Qu’en est-il de leur application ? “Le problème, c’est la mise en œuvre du droit. Parce que le droit, c’est un rapport de force. C’est vrai au niveau local et c’est encore plus vrai au niveau international.” Il existe ainsi des dizaines de résolutions qui affirment que les Palestinien·nes ont le droit au retour sans que rien n’ai jamais été fait pour leur permettre de retourner sur leurs terres. “La CIJ a émis trois ordonnances juridiquement contraignantes, notamment pour qu’Israël fournisse des services de base et une assistance humanitaire aux Gazaoui·es. Mais elles n’ont jamais été mises en œuvre par Israël. La Cour a d’ailleurs fait le constat, lorsqu’elle a rendu sa deuxième et troisième ordonnance, du non-respect de ses obligations”, relève Insaf Rezagui.
L’enjeu est donc avant tout politique. L’ordre du monde est structurellement impérialiste et colonial. Cela signifie que notre société est organisée de manière à défendre cet ordre et le droit international n’y fait pas exception. Il est né dans un contexte européen pour les États européens. Et si d’autres États, notamment des pays du Sud global, luttent pour le transformer, l’asymétrie de pouvoir reste bien réelle. Ainsi, le droit international a permis et permet toujours d’encadrer et de justifier les rapports de domination, et donc de défendre les intérêts des États occidentaux.
C’est ce qui se joue avec la Palestine. Les États-Unis mobilisent par exemple systématiquement leur droit de véto pour s’opposer aux résolutions concernant le génocide en cours contre le peuple palestinien. “Au Darfour, les mandats émis par la Cour pénale internationale contre Omar El-Béchir sont restés sans effet faute de coopération, car derrière ces crimes se jouent aussi des alliances politiques stratégiques, détaille Océane Toukam. Ce n’est jamais uniquement “un État contre des rebelles” ou “un État contre un autre État” mais un ensemble de relations géopolitiques et d’intérêts économiques qui déterminent l’application, ou non, du droit international.”
Ces relations géopolitiques sont encore aujourd’hui structurées par la domination impérialiste qui s’est poursuivie, même après les Indépendances, notamment “à travers des institutions financières internationales comme le FMI qui imposent leurs règles au pays du Sud sans leur laisser une réelle marge de manœuvre”.
La reconnaissance de la Palestine, un blanchiment occidental
Le 22 septembre dernier, plusieurs États, dont la France et la Belgique, ont reconnu l’État de Palestine. Pour Insaf Rezagui, il s’agit avant tout d’un geste symbolique, qui révèle l’ampleur de l’hypocrisie occidentale. “L’ordre colonial israélien ne va pas être démantelé demain par cette décision. Au contraire, la première chose que Benjamin Netanyahu a dit, c’est qu’aucun État palestinien ne verra le jour à l’ouest du Jourdain, en référence à la Cisjordanie. Le projet d’effacement des Palestinien·nes continue et un certain nombre de ministres israéliens appellent à l’annexion totale de l’intégralité du territoire palestinien.”
La chercheuse décrit cette séquence politique comme une tentative de blanchiment des pays européens. “D’un côté, on a des puissances occidentales qui arment, financent, légitiment le projet colonial israélien depuis des décennies. Elles le font plus que jamais en période de génocide, alors que Gaza est devenue un cimetière à ciel ouvert. Et pendant qu’elles entretiennent ce cycle de dépossession et de violences, elles tentent maintenant de se blanchir, face à l’ampleur des destructions et à une opinion publique internationale qui se lève de plus en plus contre le génocide.”
Une reconnaissance d’autant plus symbolique qu’elle n’engage pas les États occidentaux dans leur rapport avec Israël. En Belgique, cette reconnaissance ne sera actée par un arrêté royal qu’après la libération du dernier otage israélien et l’exclusion du Hamas de la gouvernance palestinienne, des conditions irréalistes qui bénéficient à l’État colonial, au détriment du peuple occupé. “Cela satisfait un peu tout le monde finalement, sauf le principal concerné par la question, c’est-à-dire le peuple palestinien, qui continue d’être génocidé.”
Agir concrètement à notre échelle
Dans ce contexte, est-il vain de mobiliser le droit international pour défendre les droits des peuples opprimés ? Non, selon Selma Benkhelifa : “Je comprends ce sentiment défaitiste mais il faut continuer à croire en la justice. Ne serait-ce que par respect pour nos ancêtres qui se sont battus pour obtenir ces droits, à travers les luttes de libération nationale et le mouvement des Non-Alignés. Même si le droit international n’est pas correctement appliqué aujourd’hui, il vaut la peine qu’on se batte pour lui.” L’avocate estime qu’il est d’autant plus urgent de le défendre aujourd’hui. “Les Nations Unies et le droit international sont fortement attaqués par la droite et l’extrême droite, qui aimeraient bien qu’ils n’existent plus pour qu’elles puissent faire totalement ce qu’elles veulent.”
“C’est vrai qu’on a l’impression que le droit international n’est pas à la hauteur de l’enjeu, mais parce qu’il ne faut pas le mobiliser seul, complète Insaf Rezagui. Il faut le mobiliser avec le reste des outils politiques et de lutte dont nous disposons. Le problème, encore une fois, c’est que le rapport de force est tellement inégalitaire que les Palestinien·nes sont un peu abandonné·es dans leur lutte décoloniale. Et c’est pour ça que la responsabilité de la société internationale est immense en la matière.”
Si le droit international montre ses limites, l’enjeu est avant tout de le décoloniser, ajoute Océane Toukam. La juriste considère les mécanismes de justice transitionnelle comme une voie complémentaire à emprunter. “Les commissions vérité, les réparations, les réformes institutionnelles ou encore les dispositifs de mémoire collective permettent de traiter les séquelles des violences de masse au plus près des sociétés concernées. Ces mécanismes s’inspirent parfois directement de pratiques locales, comme les gacaca (prononcer “gatchatcha”, littéralement “herbe douce” en kinyarwanda), des tribunaux communautaires villageois qui se déroulent en plein air au Rwanda. Cela montre que le Sud peut enrichir et transformer les approches juridiques globales.”
Autrement dit, lutter efficacement contre les rapports de domination impérialistes nécessite de s’engager concrètement sur plusieurs fronts. Aux niveaux individuels et communautaires, il s’agit d’abord de décoloniser nos propres esprits pour parvenir à penser et agir autrement qu’à travers le prisme occidental. Cela permet de se mobiliser à l’échelle nationale pour conscientiser et outiller la société civile. L’objectif : pousser les pouvoirs politiques à appliquer correctement le droit international.
“On espère qu’un jour Netanyahu sera poursuivi devant un tribunal pénal international pour génocide. Je comprends qu’actuellement, certain·es se disent que ça ne sert à rien de mobiliser le droit international. Mais il ne faut pas oublier que des horreurs comme il y en a eues pendant la guerre du Vietnam ou d’Algérie, ça a duré des années avant que les peuples ne gagnent. Mais finalement, ces peuples ont quand même gagné, conclut Selma Benkhelifa. Il y a évidemment un sentiment d’urgence quand on voit les images atroces qui nous viennent de Gaza, on a envie que ça change beaucoup plus vite, mais on ne doit pas se dire que c’est foutu.”
Rappelons que la Nakba, la catastrophe au cours de laquelle Israël a colonisé 77% du territoire palestinien, a eu lieu en 1948 et que la Palestine subit les ingérences coloniales occidentales depuis plus de 100 ans. A l’Est du Congo, la population est victime de massacres de masses perpétrés depuis 1996, soit près de 30 ans, par le Rwanda et ses alliés, notamment occidentaux. Au-delà des meurtres, le génocide en cours se matérialise également par des déplacements de masse qui rendent difficile voire inexistant l’accès à la nourriture, à un abri, aux soins de santé et à l’éducation.
Soulignons enfin que ce n’est pas le droit international qui a libéré les peuples colonisés par l’Occident, mais bien les mouvements de résistance pour les Indépendances portés par les Indigènes. Ces mobilisations ont pris et continuent de prendre des formes variées, dont la lutte armée. Présenté comme du terrorisme par les États occidentaux, ce droit à la résistance est reconnu et protégé par le droit international.

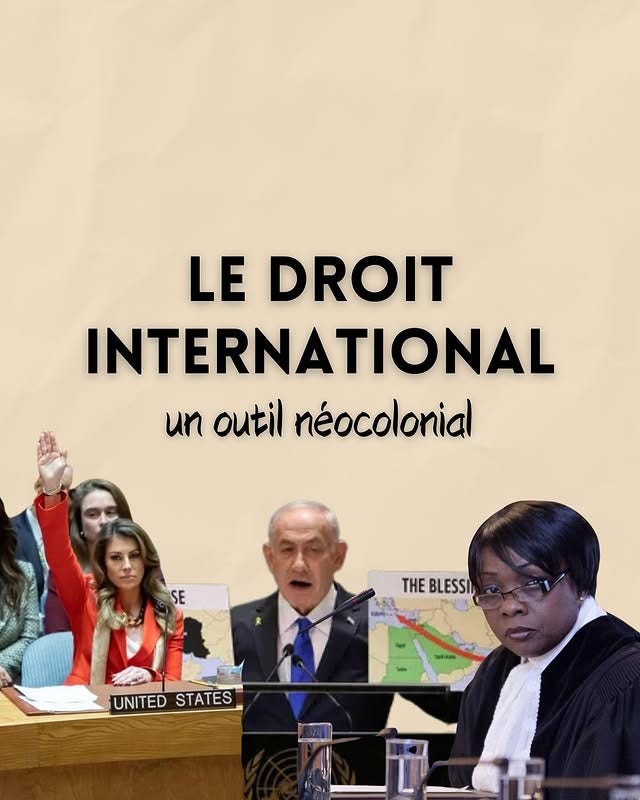

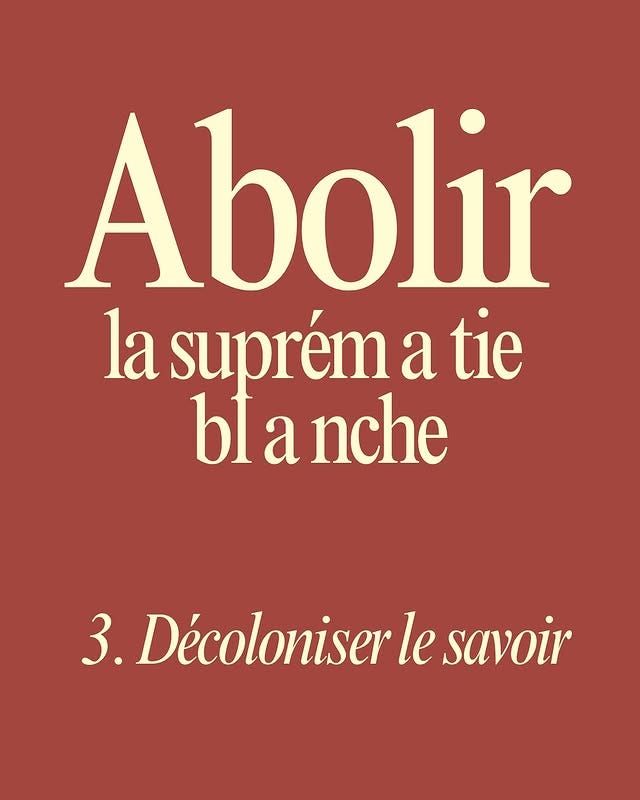
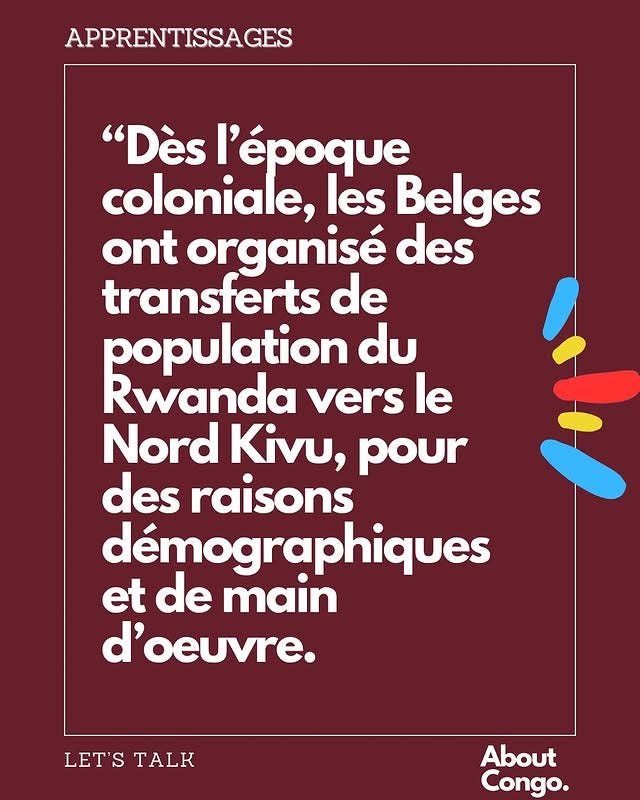
Chokran.
Merci pour ton travail ainsi que pour la qualité de tes questions. Ce fut un plaisir de contribuer à cet article.